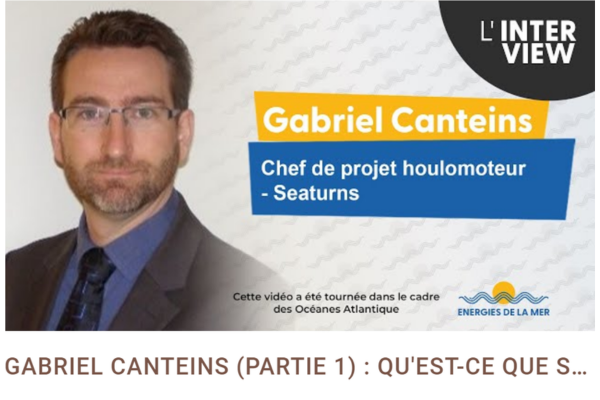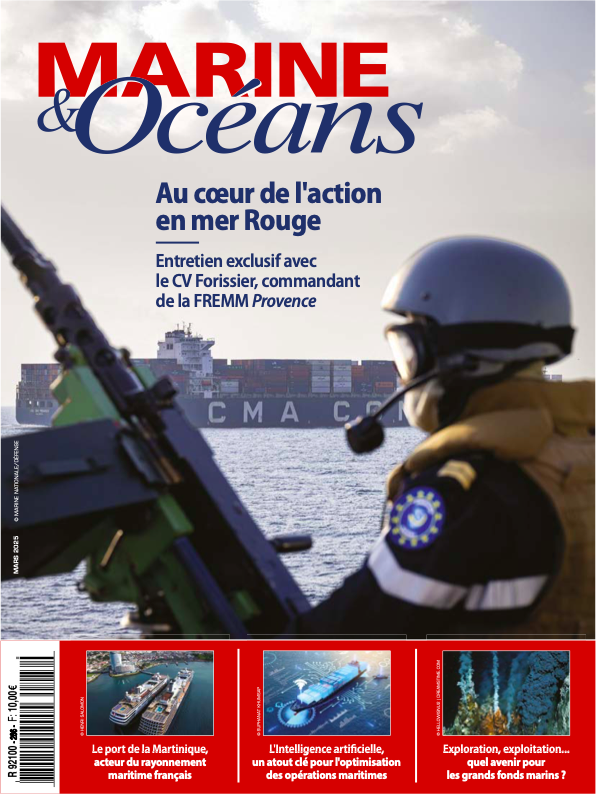France – 11/02/2025 – energiesdelamer.eu.
Comment financera-t-on l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique ?
La Loi de Finances 2025 (PLF) adoptée le 6 février 2025 affiche en termes macroéconomiques, une prévision de croissance de 0,9%. Il fixe un objectif de déficit public de 5,4% du PIB en 2025, contre les 6,1% enregistrés en 2024.
Au grand dam des communes du littoral, et de l’ANEL, l’amendement Création du Fonds Erosion Côtière n’a pas été retenu par la commission mixte paritaire, qui, à la demande du gouvernement a été retiré du PLF 2025*.
La tribune de Bernard Kalaora propose de modifier les choix par défaut pour transformer les comportements face aux risques côtiers et donne des exemples d’actions menées aux Pays-Bas, en Espagne …. alors que les collectivités littorales sont en première ligne face aux effets du changement climatique : montée des eaux, érosion côtière et submersion marine.
Ces phénomènes ne sont plus de simples projections théoriques, mais des réalités tangibles qui menacent les infrastructures, les écosystèmes et les populations. Pourtant, malgré une meilleure connaissance des risques et la multiplication des alertes scientifiques, les politiques d’adaptation peinent à produire les changements nécessaires.
Les travaux en psychologie sociale et en sciences comportementales (Kahneman, 2011 ; Thaler & Sunstein, 2008) montrent que les décisions des individus ne sont pas uniquement rationnelles, mais fortement influencées par les cadres dans lesquels elles sont prises. Plusieurs biais cognitifs (biais du statu quo, effet de groupe, illusion de contrôle) expliquent l’inaction face aux risques côtiers, même lorsque la menace est avérée.
Cet article propose une alternative aux politiques classiques : modifier les options par défaut afin d’orienter naturellement les choix vers des comportements plus résilients, sans recourir à des mesures autoritaires :
-en renforçant la résilience des infrastructures et faciliter l’adaptation des habitants.
-en promouvant des solutions basées sur la nature pour limiter l’érosion et la submersion.
-en transformant l’économie côtière (tourisme, pêche) par l’intégration de pratiques plus durables sans coercition.
Maîtriser l’urbanisation et limiter les constructions vulnérables
L’urbanisation des zones côtières s’est intensifiée ces dernières décennies, souvent sans prendre en compte les risques croissants liés à l’érosion et aux submersions marines. La difficulté des collectivités à limiter ces constructions s’explique par plusieurs biais cognitifs et sociaux :
- Le biais du statu quo : Les habitants refusent de voir leurs habitudes bouleversées et préfèrent maintenir un cadre de vie familier, même si les risques augmentent.
- L’escalade d’engagement : Un propriétaire ayant investi dans une maison ou un commerce en bord de mer sera réticent à reconnaître la nécessité de partir, car cela signifierait admettre une perte irrécupérable.
- L’effet de groupe : Si les autres habitants continuent à construire ou rénover sur le littoral, il devient difficile pour un individu de prendre la décision inverse.
Construction hors des zones à risque par défaut
- Option actuelle : Les collectivités doivent justifier le refus de permis de construire dans les zones à risque, ce qui entraîne des conflits et des recours juridiques.
- Option par défaut proposée : Toute nouvelle construction est automatiquement refusée dans les zones exposées à l’érosion ou à la submersion.
- Seule exception : Si le promoteur démontre que le projet est résilient sur 50 ans (ex. construction sur pilotis, matériaux adaptés).
- Exemple : Aux Pays-Bas, certaines zones côtières ont adopté une règle où les nouvelles constructions doivent prouver leur capacité à flotter ou à être déplacées pour obtenir un permis.
Reconversion des zones inconstructibles en espaces naturels protégés
- Option actuelle : Les terrains frappés d’interdiction de construire restent en friche ou sont revendiqués par des propriétaires cherchant des compensations.
- Option par défaut proposée : Tout terrain inconstructible est automatiquement converti en réserve naturelle ou en zone tampon (ex. dunes, marais).
- Exemple : En Bretagne, certaines anciennes parcelles agricoles exposées à la montée des eaux ont été transformées en zones humides tampons qui protègent les terres en arrière-littoral.
Renforcer la résilience des infrastructures et faciliter l’adaptation des habitants
Recul stratégique des infrastructures publiques
- Option actuelle : Les routes et bâtiments publics sont reconstruits sur place après chaque tempête, souvent avec des protections artificielles coûteuses.
- Option par défaut proposée : Lorsqu’une infrastructure publique atteint la fin de sa durée de vie, elle est automatiquement reconstruite plus en retrait.
- Exemple : En Nouvelle-Zélande, certaines écoles situées en zone côtière ont été relocalisées dès qu’un nouveau bâtiment devait être construit, au lieu de simplement rénover les structures existantes.
Fiscalité et assurances : incitations automatiques à l’adaptation
- Option actuelle : Les aides aux propriétaires pour adapter leur maison sont optionnelles et peu demandées.
- Option par défaut proposée : Toute maison située en zone à risque bénéficie automatiquement d’une prime d’adaptation si elle adopte des solutions résilientes (ex. toits végétalisés, surélévation).
- Exemple : En Floride, les maisons construites sur des pieux reçoivent des réductions automatiques sur leurs assurances.
Promouvoir des solutions basées sur la nature pour limiter l’érosion et la submersion
Renaturation automatique des littoraux érodés
- Option actuelle : Les plages artificielles sont reconstruites chaque année avec du sable dragué, une solution coûteuse et inefficace à long terme.
- Option par défaut proposée : Toute plage sujette à l’érosion est automatiquement restaurée par des solutions naturelles (dunes, marais salants).
- Exemple : En Camargue, la gestion du trait de côte repose sur la reconstitution de dunes naturelles fixées par la végétation, au lieu d’ajouter du sable artificiel
Replantation des herbiers sous-marins et des récifs artificiels
- Option actuelle : La protection des habitats sous-marins est souvent laissée aux initiatives locales, sans politique systématique.
- Option par défaut proposée : Lorsqu’un port ou une digue est construite, une compensation sous forme de récifs artificiels ou de plantation d’herbiers est systématiquement appliquée.
- Exemple : Aux États-Unis, les récifs d’huîtres ont été restaurés en Louisiane pour amortir les vagues et réduire l’érosion côtière.
Transformer l’économie côtière en intégrant des pratiques plus durables
Hébergements et infrastructures mobiles par défaut
- Option actuelle : Les restaurants et installations touristiques sont souvent fixes et exposés aux aléas climatiques.
- Option par défaut proposée : Toute nouvelle infrastructure sur la plage est obligatoirement démontable.
- Exemple : Sur l’île de Ré, des restaurants mobiles ont été privilégiés pour s’adapter aux mouvements du trait de côte.
Taxe de résilience intégrée aux locations touristiques
- Option actuelle : Les taxes touristiques financent principalement les services municipaux classiques.
- Option par défaut proposée : Chaque nuitée en hébergement côtier inclut une contribution obligatoire à la protection du littoral.
- Exemple : En Espagne, certaines régions ont instauré une « taxe verte » sur les locations de vacances, dédiée à la préservation du trait de côte**.
Modifier les règles du jeu pour une adaptation douce et efficace
L’adaptation au recul du trait de côte et à la submersion marine pose une question essentielle : comment faire évoluer nos comportements et nos décisions sans générer de résistances sociales, tout en garantissant une protection efficace des territoires littoraux ? Face à l’échec des approches purement réglementaires et des politiques volontaires peu suivies, une réécriture des choix par défaut pour encourager des solutions durables sans contrainte directe est proposée
Cette approche repose sur un changement subtil mais profond du cadre décisionnel : plutôt que d’attendre que les individus fassent le « bon choix » face à des enjeux environnementaux complexes, changeons les règles du jeu pour que la meilleure option soit la plus évidente, la plus simple, et parfois même la seule qui s’impose naturellement. Ainsi, les collectivités locales peuvent intégrer la résilience et la protection du littoral non pas comme une contrainte, mais comme un automatisme : une maison construite plus en retrait, une infrastructure publique déplacée en arrière-littoral, une taxe intégrée aux séjours touristiques pour financer la protection des côtes, ou encore des solutions fondées sur la nature favorisées par défaut.
Une approche inspirée de la philosophie de The Ocean in a Drop
Ce travail s’inspire en partie de la vision développée par Rosalind Savage dans The Ocean in a Drop: Navigating from Crisis to Consciousness, où elle montre que la transformation environnementale ne passe pas uniquement par des politiques globales, mais aussi par un changement de conscience à l’échelle individuelle et locale.
Dans son ouvrage, elle explore comment chaque action humaine, même la plus infime, reflète et façonne un système plus vaste, tout comme une seule goutte d’eau contient en elle l’essence de l’océan tout entier. Cette métaphore trouve ici une résonance particulière dans l’idée que les options par défaut sont une manière de redistribuer la responsabilité de l’adaptation à tous les niveaux, du citoyen à l’institution, de l’échelle locale à la dynamique globale.
Si nous considérons que chaque aménagement côtier, chaque décision urbanistique et chaque infrastructure publique est une « goutte » dans l’ensemble du système littoral, alors modifier ces gouttes revient à transformer progressivement la dynamique de l’océan entier. Autrement dit, c’est en repensant la manière dont les décisions sont prises, et en intégrant les bons réflexes dès l’origine, que l’on peut modifier le destin de nos littoraux sans conflit, sans rupture brutale, mais avec la fluidité et l’intelligence du vivant.
Les options par défaut : un moyen efficace de réduire la dissonance cognitive****
Un autre avantage essentiel de l’intégration des options par défaut dans les politiques d’adaptation côtière est leur capacité à réduire la dissonance cognitive, ce phénomène psychologique où un individu ressent un malaise face à un conflit entre ses valeurs et ses actions.
Dans le cas de la gestion du trait de côte et des submersions, la dissonance cognitive se manifeste souvent ainsi :
- Un habitant reconnaît que l’érosion et la montée des eaux menacent sa maison, mais continue de rénover et d’investir dans des protections temporaires, refusant d’envisager une relocalisation.
- Un élu local admet que les digues ne suffiront pas à long terme, mais continue de financer leur renforcement car reculer est politiquement impopulaire.
- Un touriste comprend que l’artificialisation des plages est nuisible, mais préfère choisir un hébergement en bord de mer qui profite des infrastructures existantes.
L’option par défaut allège cette dissonance, car elle intègre automatiquement le « bon » choix sans forcer une remise en question brutale. L’individu n’a plus besoin d’arbitrer un dilemme moral ou économique, car la norme a déjà changé autour de lui.
L’individu n’a plus besoin d’arbitrer un dilemme moral ou économique, car la norme a déjà changé autour de lui. Si les options par défaut permettent de faciliter l’adoption de comportements résilients sans effort conscient, elles ne signifient pas pour autant une absence totale de prise de conscience. Au contraire, elles créent progressivement un nouveau cadre mental et une transformation des normes sociales, qui conduisent à une sensibilisation indirecte mais profonde.
POINTS DE REPÈRE
* Un amendement présenté par Sophie Panonacle, députée de Gironde, et Présidente du Comité National du Trait de Côte (CNTC), avait été voté à l’Assemblée nationale et au Sénat afin de répondre au besoin de financement des projets d’adaptation des communes littorales exposées au recul du trait de côte. » Le fonds devait être abondé grâce aux recettes engendrées par une nouvelle taxe sur les exploitants de plateformes de location touristique de courte durée comme préconisé par le Comité National du Trait de Côte lancé 14 mars 2023 sous le Gouvernement Attal.
** En France, Sophie Panonacle, Députée de Gironde, avait proposé, dans le projet de Loi de Finances 2025, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et une taxe de publicité foncière au profit de l’État qui doit permettre le financement des projets de protection, de renaturation ou encore de relocalisation pour les communes impactées par l’érosion côtière.
*** Océanes Atlantique 23 et 24 septembre 2024 – Projet TerMer de Charlotte Michel porté par LittOcéan et soutenu par la Fondation de France.
**** Le concept de dissonance cognitive est élaborée par Léon Festinger en 1957. Lorsqu’un individu agit en contradiction avec ses propres cognitions, il se retrouve dans un état psychologique inconfortable voire douloureux. C’est ce qui est appelé la dissonance cognitive. Les individus cherchent alors à limiter ce conflit interne en trouvant des justifications à leurs comportements
 Bernard Kalaora, socio-anthropologue est membre du laboratoire de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC), piloté par le CNRS et l’EHESS.
Bernard Kalaora, socio-anthropologue est membre du laboratoire de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC), piloté par le CNRS et l’EHESS.
Il a été professeur de sociologie de l’environnement à l’UPJV d’Amiens et chercheur associé au Laboratoire d’anthropologie des institutions et organisations sociales (EHESS/LAIOS).
Consultant auprès d’organisations nationales et internationales dédiées à la gouvernance de la mer et du littoral, Bernard Kalaora est ancien président de l’association LITTOCEAN, un laboratoire d’idées visant à développer la dimension maritime de l’action publique.
Entre autres ouvrages, il est le co-auteur, avec Guillaume Decocq et Chloé Vlassopoulos, de La Forêt salvatrice : reboisement, société et catastrophe au prisme de l’histoire, publié aux éditions Champ-Vallon en 2016.
A lire ou relire Mayotte par Bernard Kalaora sur AOC et The Conservation
Rebâtir après Chido : le rêve d’une Mayotte résiliente Bernard Kalaora – 09/02/2025
La reconstruction qui s’impose maintenant peut devenir une chance : Mayotte, forte de ses ressources humaines et naturelles, peut devenir le modèle d’un urbanisme vivant et résilient.
Mayotte : histoire coloniale, fractures sociales et désastre environnemental – 20/12/2024
autres liens :
Les Océanes Atlantique 2024 : Journée d’ateliers le 23 septembre 2024 projet TERMER de LittOcean, soutenu par la Fondation de France, Relevés de dommages à terre dus aux submersions marines Définition d’une liste minimale de champs indispensables pour caractériser au mieux les dommages liés à un événement tempétueux sur le littoral : la liste métier CRISUM. Décembre 2024
Relevés de dommages à terre dus aux submersions marines, un rapport du CEREMA
Sophie Panonacle : la création du Fonds Érosion Côtière a été actée
Abonnez-vous aux articles complets, publiés dans les newsletters, ou inscrivez-vous gratuitement au Fil info de l’agence de presse d’energiesdelamer.eu.
Avec l’abonnement (nominatif et individuel) l’accès est illimité à tous les articles publiés.
Abonnements : Aziliz Le Grand – Mer Veille Energie
Suivez-nous sur les réseaux sociaux Linkedin et Facebook
Le Business Directory, répertoire des membres soutiens d’energiesdelamer.eu. Les adhésions des membres permettent l’accès gratuit aux articles publiés sur leurs activités par energiesdelamer.eu. Véritable outil, la base de données comprend, depuis le 15 janvier 2025, plus de 10 300 articles d’actualité indexés quotidiennement.
Publicités Google :