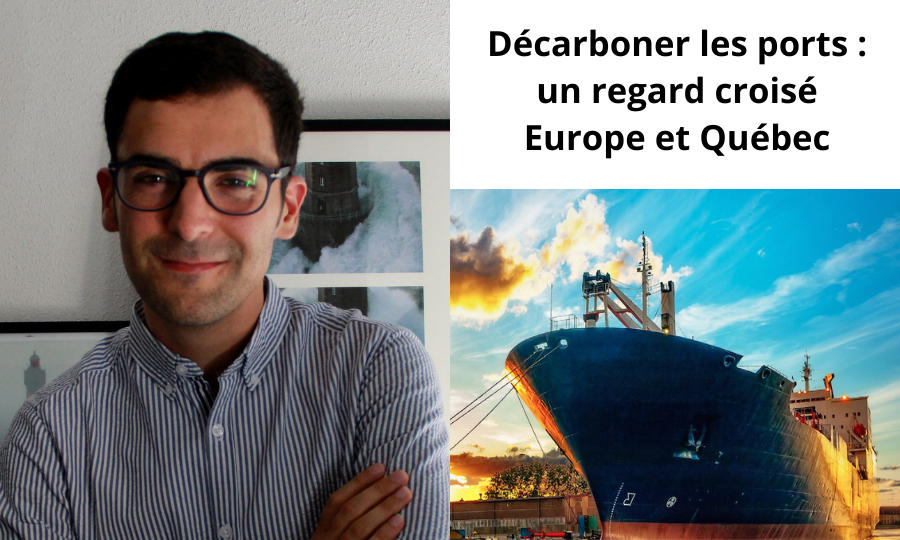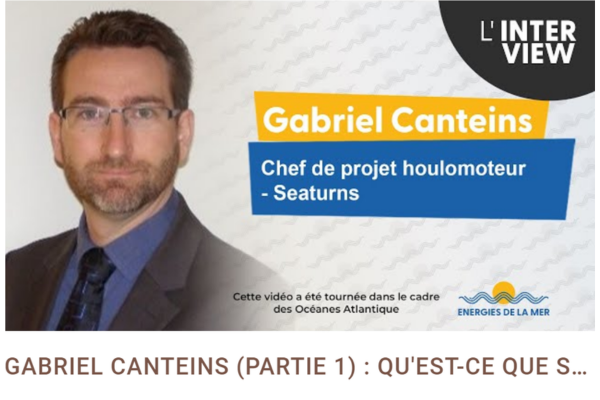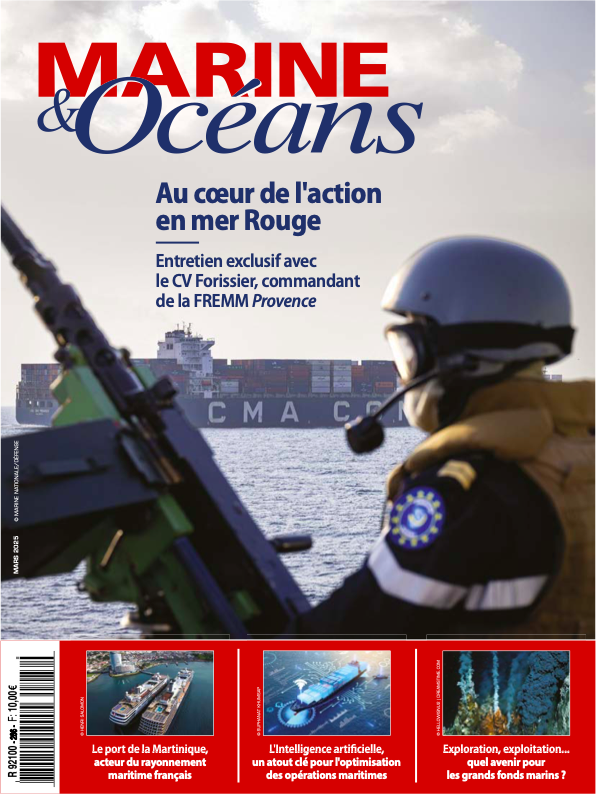France – 10/02/2025 – energiesdelamer.eu.
Les écosystèmes portuaires sont aujourd’hui à la croisée des chemins pour répondre aux enjeux de neutralité carbone.
A l’interface des politiques énergétiques, des politiques environnementales et des politiques des transports, les ports doivent répondre à un triptyque complexe : la décarbonation, la réindustrialisation et la résilience. Quelles sont les trajectoires suivies aujourd’hui en Europe et au Québec pour faire des ports des acteurs moteurs de la transition énergétique ?
La tribune de Sylvain Roche a été publiée en priorité sur le blog RRI – Réseau de Recherche sur l’innovation présidé par Blandine Laperche sur le Blog d’Alternatives économiques le 7 février 2025.
Décarboner les ports : un regard croisé Europe et Québec par L’Europe bousculée par la crise géopolitique
L’impératif de transition environnementale, couplé au contexte de crise géopolitique engendré par la guerre russo-ukrainienne (augmentation du prix de l’énergie, dépendance envers le GNL américain, etc.), a ouvert une fenêtre d’opportunité inédite pour un déploiement accéléré des énergies renouvelables en Europe. En 2023, les États membres de l’UE ont investi près de 110 milliards d’euros dans la production d’énergies renouvelables.
La décarbonation et la réindustrialisation verte des ports européens s’inscrivent dans une temporalité de l’urgence, dans un contexte coercitif de bifurcation écologique et de résilience énergétique du continent (notamment dans le cadre du programme REPowerEU), en lien avec la mise en place d’une nouvelle économie bleue.
Se projetant comme des « hubs verts », de véritables « green gateways » vers une économie plus durable et compétitive, les ports entrepreneurs européens se veulent innovants à la fois au plan technologique, comme des expérimentateurs de nouvelles filières énergétiques, mais aussi au plan territorial, étant les moteurs d’un projet de développement économique local et communautaire.
Que ce soit en méditerranée ou en mer du Nord, le concept de port producteur d’énergie décarbonée, qui veut relever le défi de produire de l’énergie renouvelable au plus près des centres de consommation (nearshoring), s’impose et s’accompagne par une transition paysagère portuaire. Les énergies renouvelables font entrer les ports dans un écosystème maritimo-énergétique réinventé.
Les ports européens disposent en effet de réserves foncières pour accueillir de nouvelles industries et activités, matures ou émergentes. Dans une approche d’écologie industrielle et d’économie circulaire, les zones industrialo-portuaires (ZIP) s’équipent de réseaux de chaleur, de plateformes de carburants alternatifs ou d’éoliennes, qu’elles soient terrestres (installées dans les ports) ou offshore – les équipements sont alors construits, ou transitent, dans les ports. Un objectif de 300 GW installés d’éolien offshore d’ici 2050 est aujourd’hui ciblé par l’UE.
Parallèlement, plusieurs mesures réglementaires obligent les ports européens à se mettre en action sur le volet décarbonation du transport maritime. En effet, l’UE prévoit l’obligation pour les principaux ports européens de s’équiper en prises électriques à quai pour les navires ferry, de croisière et les conteneurs pour 2030 au plus tard (vote du paquet Fit for 55), l’objectif étant de réduire de 80% les émissions des plus gros navires voguant dans l’UE d’ici 2050 par rapport à 2020.
Au Québec, des ports « déjà verts » par l’hydroélectricité
A la différence de leurs homologues européens, les ports québécois ne sont pas redessinés par les EnR. Là où les ZIP européennes sont pleinement mobilisées et mobilisables pour produire de l’électricité afin de répondre aux enjeux de sécurité énergétique du continent, les ports québécois ne sont pas vus, à ce jour, comme des « hubs de production d’énergie » mais essentiellement comme des plateformes logistiques, des ports de transit, avec tout ce qui tourne autour de la conteneurisation.
Contrairement à l’Europe, la réalité des coûts de l’énergie (et notamment de l’électricité) n’a pas encore rattrapé les ports québécois, où perdure une culture d’abondance. Aussi, il n’y a pas forcément d’avantage à accueillir des énergies renouvelables en zone portuaire, car l’électricité produite au Québec est déjà verte et pas chère car totalement amortie (94% de l’électricité est d’origine hydraulique). Ainsi, le sentiment d’urgence à agir, la perception de la crise énergétique et économique, de la finitude des ressources, ainsi que les enjeux de sobriété, paraissent moins palpables qu’en Europe.
Etant « déjà verts », les ports peuvent se targuer d’avoir cet avantage différenciatif à l’international (d’ailleurs comme la France à un degré moindre avec le nucléaire historique) pour attirer les investisseurs étrangers (marketing territorial). Il y aurait donc un paradoxe assumé entre l’existence d’une électricité verte et pas chère et la réalité des actions de décarbonation entreprises par les ports du Saint-Laurent. Aussi, pour les ports québécois, la transition écologique ne se jouerait pas (encore) dans la production d’électricité verte mais principalement dans le fait d’en consommer moins et surtout mieux (des efforts ont été demandés aux ports français à cet égard).
De plus, malgré l’immensité du territoire québécois, les ports ne disposent pas toujours de l’espace nécessaire pour développer des technologies et industries fortement demandeuses d’espace. Tout comme les agendas énergétiques nationaux, la physionomie territoriale inscrit la décarbonation des ports dans des trajectoires différentes. Enfin, l’absence d’une pression réglementaire, ainsi que l’absence de mandat à produire de l’énergie à ce jour (les ports fédéraux sont régis par la loi maritime) n’encourage pas à l’action, même si la décarbonation des ports ne s’opère pas dans un vide institutionnel.
Mutualiser les efforts de décarbonation : le rapprochement interportuaire
La décarbonation des ports oblige à jongler entre l’agenda fédéral (les stratégies portuaires) et le niveau provincial (les stratégies énergétiques et environnementales), à l’image du plan fédéral Transport 2030 ou des plans d’orientation stratégique d’Hydro-Québec. La décarbonation des ports impose à co-construire des politiques publiques innovantes, multiscalaires et transversales, pour dépasser les limites des frontières institutionnelles classiques.
Des luttes de cadrage et des rapprochements stratégiques se jouent donc dans les ports québécois pour peser sur les enjeux de décarbonation par un effet de taille. S’inscrivant dans une démarche de coopération interportuaire via l’axe Saint-Laurent, le Port de Montréal, de Trois-Rivières et de Québec ont ainsi rejoint le défi carboneutre du gouvernement du Canada en mai 2023 (notons ici que le Port de Saguenay et Port de Sept-Îles ont rejoint l’entente de collaboration interportuaire cet été). En reprenant les mots du le PDG du Port de Québec, « Il faut penser le Saint-Laurent comme notre capital […] Il faut décarboner ensemble nos activités ».
Effectivement, en étant des petits joueurs en termes de consommation d’électricité et en termes de GES, les ports sont passés sous les radars d’Hydro-Québec ces dernières années, la prérogative étant donnée à la décarbonation des industries lourdes polluantes (cimenteries ou aluminerie par exemple) et surtout au transport individuel (voiture électrique). En 2020, le transport terrestre représentait 33,5% des GES au Québec contre 1,5% pour le transport maritime.
Priorité donnée à l’électrification des quais
Pour autant, le Saint-Laurent reste confronté à la problématique des croisières et à leur régulation. Les politiques de Green Corridor, plutôt à l’initiative des compagnies maritimes qu’à celle des ports, se présentent comme une pression économique, de concurrence, qui met les autorités portuaires mondiales dans une dynamique d’action (La Cruise Lines International Association vise une industrie neutre d’ici 2050). C’est d’ailleurs dans ce contexte que les efforts d’électrification portent dans un premier temps sur les navires de croisière (70% des émissions des GES des ports du Saint-Laurent proviennent des navires à quai), ceci répondant à une logique économique de récurrence des activités (l’industrie du tourisme saisonnier), ainsi qu’à des logiques de spécialisation technologique (petits bateaux de type traversiers aisément électrifiables).
Le Port de Montréal a ainsi profité d’une aide fédérale de 2017 pour impulser l’électrification de ses quais, représentant aujourd’hui 43 systèmes électriques répartis sur l’ensemble de la zone portuaire. Lors de la rencontre du Forum de concertation sur le transport maritime du 19 janvier 2022, un groupe de travail sur la décarbonation de l’industrie maritime a été créé « afin de soutenir et d’accompagner le gouvernement du Québec dans l’élaboration d’outils permettant à l’industrie maritime québécoise d’atteindre les cibles fixées en matière de décarbonation du secteur ».
« Mariniser » Hydro-Québec pour électrifier les ports
Pris dans une course à la modernisation de leurs infrastructures et dans des démarches d’anticipation stratégique, l’approvisionnement en électricité des ports reste soumis à un jeu de lobbying avec l’objectif d’avoir les arbitrages favorables d’Hydro-Québec, société d’État étant forcée d’être de plus en plus sélective au regard de la croissance projetée de la demande d’électricité prévue d’ici 2050 (de 55%) faisant craindre un risque de pénurie dans les prochaines années.
Les initiatives portées par le Port de Québec, afin qu’Hydro-Québec libère des volumes d’électricité (le port vise à réduire ses GES d’au moins 50 % d’ici 2030 par rapport à 2022 via l’électrification des quais), s’inscrit dans cette logique de rapport de force. Selon un représentant du secteur maritime québécois rencontré en 2023, « Le gouvernement a réalisé qu’il va tomber en déficit énergétique en 2026, année où la majorité des ports veulent mettre en fonction leurs bornes électriques à quai ». Nul doute que la décarbonation des ports québécois devra s’accompagner d’une « marinisation » à marche forcée d’Hydro-Québec afin qu’ils puissent se décarboner au rythme qu’ils souhaitent. C’est une chose de dire qu’on veut électrifier les ports. C’en est une autre d’amener de nouveaux pylônes et de nouvelles lignes électriques, à la fois sur un plan technologique mais aussi budgétaire.
Soumis à des fortes controverses, le projet de loi n°69, porté aujourd’hui par le Ministère de l’Energie du Québec, pourrait ouvrir, à un horizon plus ou moins lointain, la possibilité de déployer des petits parcs éoliens terrestres sur les zones portuaires, à l’image de ce qui se fait aujourd’hui en Europe. La planification de la décarbonation des ports québécois ne pourra donc se faire sans une planification énergétique globale de la Province du Québec.
Des ports comme moteurs de développement économique local
Les ressources énergétiques, les histoires nationales, les cultures locales, les marchés ainsi que les processus institutionnels orientent aujourd’hui l’agenda de décarbonation des ports européens et québécois. En Europe, le contexte de crise systémique des 3E (crise économique, énergétique et environnementale) conscientisée, source de fortes tensions sociales et politiques, oblige les ports à bifurquer de manière plus rapide et sous contrainte.
Pour autant, même si le rythme est différent, de vastes ZIP sont aujourd’hui en phase de reconversion des deux côtés de l’Atlantique afin de permettre le déploiement de nouvelles filières énergétiques, créatrices d’emplois. Face au triple défi « décarbonation, réindustrialisation, résilience », les ports peuvent être des moteurs de transformation des territoires « en créant de la valeur économique aux niveaux micro (entreprises) et méso (territoire) ». Et à ce titre, des synergies vertueuses entre acteurs privés, organismes publics et le monde de la recherche paraissent cruciales. Que ce soit en Europe ou au Québec, la décarbonation est définie dans les discours comme un important foyer d’opportunités de développement économique à saisir.
A Québec, le Parc Industriel et Portuaire de Bécancour se présente comme un organisme structurant pour porter sur le territoire le projet de Vallée de la Transition Énergétique (VTE), dans le secteur des batteries électriques et des e-carburants notamment. Le port de Bécancour est à l’heure actuelle en train de procéder à de nombreux aménagements pour accueillir l’implantation de ces entreprises. En France, les projets ZIBAC (zone industrielle bas carbone), lancés dans le cadre de France 2030, doivent accompagner et financer la décarbonation des sites particulièrement émetteurs en GES, dont les ZIP, à l’image de Fos-sur-Mer, du Havre, de Nantes-Saint-Nazaire ou encore de Bordeaux. Dans cette logique, les ports se projettent à moyen et long terme comme des territoires producteurs/consommateurs d’hydrogène vert, dans une démarche de circuit court territorialisé.
Encourager les coopérations scientifiques interportuaires transatlantiques
De nombreuses collaborations existent aujourd’hui entre le Québec et l’Europe. La décarbonation rend concrète l’importance de la coopération entre les ports, soulignant cette dualité permanente entre pragmatisme opérationnel local et mondialisation concurrentielle. À l’occasion de la 26ème COP sur le climat à Glasgow, le Port d’Anvers et le Port de Montréal ont signé une entente de collaboration qui vise à soutenir la création d’un premier corridor maritime vert dans l’Atlantique Nord. De même, la proximité des écosystèmes du Saint-Laurent et de l’axe Seine permettrait d’envisager des échanges et travaux coopératifs entre la France et le Québec, notamment sur le volet académique.
Enfin, la transition énergétique et la recherche portuaire représentent des immenses terrains de jeux pour valoriser l’expertise citoyenne et la recherche académique franco-québécoise, tout comme les vulnérabilités liées au changement climatique (travaux sur les jumeaux numériques entre le fleuve Saint-Laurent et l’estuaire de la Gironde). Des initiatives et projets scientifiques ont été lancés des deux côtés de l’Atlantique (par exemple en France via le cluster de recherche Cargo, la récente chaire Transitions Portuaires & Maritimes ou encore les travaux portés par l’Université du Littoral Côte d’Opale, et au Québec, via le réseau MerLIN de la Technopole maritime du Québec, le centre de recherche appliquée Nergica ou encore l’Université de Montréal). Créé en 2016, l’Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime (IFQM) se donne pour mission de réunir et d’animer en France et au Québec, sous forme de réseau, les acteurs clés de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur dans le secteur maritime.
L’enjeu serait donc de mettre toutes ces dynamiques en synergie, à l’image de ce qui a été initié à l’automne 2024 en France lors des Océanes Atlantique ou à Montréal lors du salon énergiQ, afin de tirer des enseignements et des inspirations pour nos deux pays sur le volet de la décarbonation des ports, et plus largement, sur nos modèles énergétiques.
POINTS DE REPÈRE
Regards croisés entre la France et le Québec
Sylvain Roche est intervenu lors des Océanes Atlantique le 24 septembre 2024 lors de la table ronde Décarbonation des ports et transition énergétique. Il a présenté les projets ZIBAC, projet ports de la nouvelle-aquitaine et EMR – regards croisées Nouvelle-Aquitaine. Mélissa Sanikopoulos, Directrice, Environnement et développement durable – Port de Sept-Iles – Québec (Canada) est intervenue sur la démarche décarbonation du Port de Sept-Iles, Nathalie Melcion, a présenté le Cluster Cargo – décarbonation du transport maritime Centrale Nantes et Nantes Université et financé dans le cadre de Nantes Trajectoire d’Excellence (NExT). Lors de la table ronde précédente Mathilde Fernandes, coordinatrice de la Chaire transitions portuaires et maritimes – UBO, avait expliqué les objectifs de la nouvelle Chaire co-dirigée par Gaëlle Gueguen et Eric Foulquier, qui a été créée à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO).
Dans la foulée, Sylvain Roche a participé au colloque Energiq 2024, organisé par InnovEE et l’AIEQ, qui s’est tenu du 15 au 17 octobre à Montréal.
Abonnez-vous aux articles complets, publiés dans les newsletters, ou inscrivez-vous gratuitement au Fil info de l’agence de presse d’energiesdelamer.eu.
Avec l’abonnement (nominatif et individuel) l’accès est illimité à tous les articles publiés.
Abonnements : Aziliz Le Grand – Mer Veille Energie
Suivez-nous sur les réseaux sociaux Linkedin et Facebook
Le Business Directory, répertoire des membres soutiens d’energiesdelamer.eu. Les adhésions des membres permettent l’accès gratuit aux articles publiés sur leurs activités par energiesdelamer.eu. Véritable outil, la base de données comprend, depuis le 15 janvier 2025, plus de 10 300 articles d’actualité indexés quotidiennement.
Publicités Google :